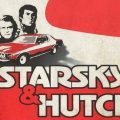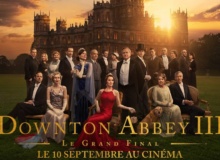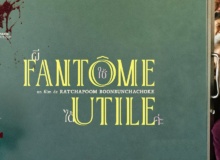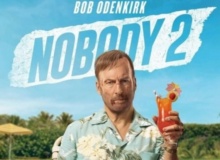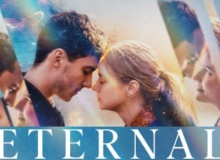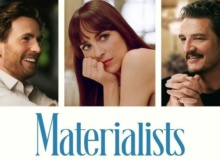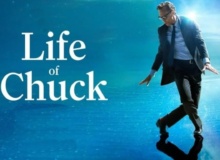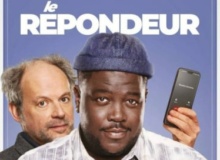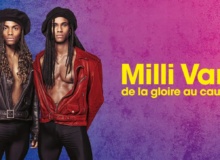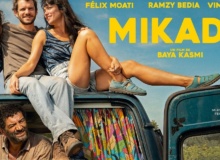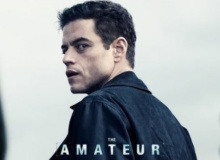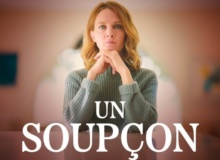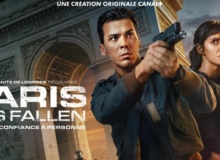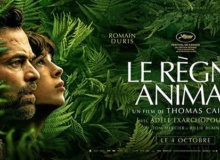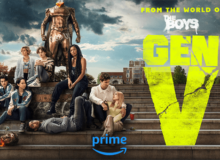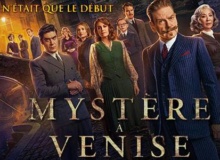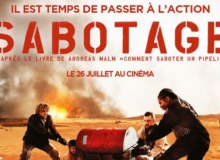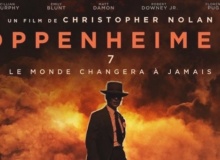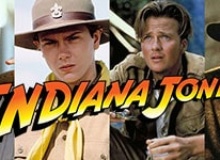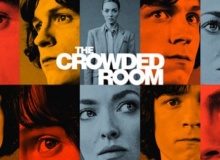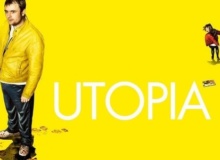Adaptation très réussie du jeu vidéo de simulation de marche éponyme, Exit 8 piège un homme dans un couloir du métro de Tokyo où temps et espace sont distordus. Plus qu’un simple thriller fantastique, le second long métrage de Genki Kawamura est une réflexion profondément symbolique sur la condition humaine : enfermée dans ses routines, confrontée à ses choix, effrayée par l’engagement mais en quête de sens. Le réalisateur revient sur Exit 8, miroir existentiel où la véritable horreur est plus à l’intérieur qu’à l’extérieur quand il s’agit de décider quelle voie emprunter dans sa vie, qui sort en salles ce 3 septembre.
Comment résumeriez-vous l’histoire de votre long métrage, Exit 8 ?
Genki Kawamura : Ce film se déroule entièrement dans un couloir souterrain qui se répète à l’infini. Grâce à ses visuels et à son design sonore, le spectateur aura l’impression d’avoir pénétré l’une des illusions d’optique d’Escher — pris dans un brouillard onirique. Alors que le protagoniste progresse dans ce couloir, il doit repérer des « anomalies » troublantes et chercher la sortie numéro 8. Une seule règle : faire demi-tour s’il y a une anomalie, avancer s’il n’y en a pas. Cependant, cette règle apparemment simple plonge le voyageur égaré dans une spirale de peur et de paranoïa.
À la base, Exit 8 est un jeu vidéo. Pourquoi vouliez-vous l’adapter ?
Je désirais réaliser un film d’horreur se déroulant dans le Tokyo moderne, brouillant les frontières entre rêve et réalité, temps et espace — à l’image des Contes de la lune vague après la pluie de Kenji Mizoguchi, un film que j’admire profondément. En cherchant le bon motif, je suis tombé sur ce jeu indépendant intitulé Exit 8. Il m’a captivé.
Le design du jeu — un passage souterrain stérile, propre et ordonné, typiquement tokyoïte — devient un cauchemar en boucle sans échappatoire. Le joueur doit détecter des « anomalies » subtiles dans ce couloir infini et tenter d’atteindre l’insaisissable Sortie 8. Bien que fortement ancré dans une esthétique japonaise locale, le jeu évoque une peur primitive et universelle. Il m’a rappelé le purgatoire de la Divine comédie de Dante — un mécanisme révélant les péchés et angoisses cachés que nous portons tous.
J’ai senti que ce point de départ me permettrait de faire évoluer l’approche de réalisme magique qui caractérisait mon film précédent, N’oublie pas les fleurs [il y montrait un monde chaotique et une réalité fragmentée vus à travers les yeux d’une femme atteinte de démence, en reliant différents éléments de temps, d’espace et de son dans des plans-séquences, NDLR].
En tant que romancier [Deux milliards de battements de cœur, publié en 2012], j’ai également vu un potentiel cinématographique immense dans cet univers minimaliste aux règles simples. J’ai grandi en regardant des œuvres de Kenji Mizoguchi et de Stanley Kubrick avec mon père, lui-même cinéaste. En parallèle, j’étais profondément immergé dans les jeux vidéo et l’animation japonais. Ce double héritage — entre cinéma classique et culture visuelle contemporaine — me semblait idéal pour créer un thriller unique en son genre.
Que symbolise pour vous ce couloir en boucle ?
Nos routines quotidiennes. Les anomalies représentent la culpabilité latente, les péchés du protagoniste ou ceux de la société en général. Nous suivons tous des routines apparemment banales tout en percevant des signes subtils indiquant que quelque chose cloche dans le monde. Ces fragments peuvent sembler insignifiants, mais ils révèlent une réalité plus profonde. Les ignorons-nous au risque de nous perdre dans un monde sans issue ? Ou les reconnaissons-nous pour aller vers la lumière ? Que nous en soyons conscients ou non, c’est une décision que nous prenons chaque jour. Le couloir blanc pourrait être un purgatoire qui nous confronte à nos fautes — ou peut-être un utérus métaphorique.
Pourquoi avez-vous choisi ces acteurs ?
Kazunari Ninomiya, qui joue L’Homme perdu, avait été repéré par Clint Eastwood pour Lettres d’Iwo Jima (2006). Il dégageait quelque chose de magnétique, une qualité qui captait l’attention. Je voulais redonner vie à cette présence, d’autant plus que cela faisait près de 20 ans qu’il n’était pas apparu dans un film distribué à l’international.
Dans Exit 8, L’Homme perdu est le protagoniste principal. Cependant, il n’a ni nom ni quasiment aucun dialogue — tel un avatar de jeu vidéo ou un symbole de la société elle-même. Je pensais que ce rôle permettrait à Ninomiya de faire ressortir son aura singulière. De plus, sa passion pour les jeux vidéo l’a aidé à saisir intuitivement le ton du film.
Yamato Kôchi, qui interprète L’Homme qui marche, a principalement travaillé au théâtre. Il possède une expérience scénique idéale pour un rôle exigeant des mouvements précis et impassibles, à la manière d’un acteur de Nô. Il se trouve également qu’il ressemble trait pour trait au personnage du jeu original, ce qui en faisait le choix parfait.
Naru Asanuma, qui prête ses traits à L’Enfant, a été choisi à l’issue d’un casting de plus de 300 enfants. Il n’avait jamais joué de rôle majeur auparavant, c’est pratiquement ses débuts. Ses yeux d’une expressivité saisissante nous ont immédiatement convaincus. Sa présence a indéniablement élevé l’ensemble du film.
Nana Komatsu, qui joue La Femme, a été repérée par Martin Scorsese pour Silence (2016). Depuis, elle a principalement travaillé au Japon, alternant entre sa carrière d’actrice et celle de mannequin en tant qu’ambassadrice Chanel. Je voulais faire découvrir Ninomiya au public international comme un talent japonais exceptionnel. Elle possède une présence éthérée unique, digne des actrices des films de Kenji Mizoguchi.
Qu’espérez-vous que les spectateurs retiennent d’Exit 8 ?
Le film commence avec un écran de smartphone, car c’est la vision la plus familière de notre quotidien moderne. Il démarre dans la réalité — et avant qu’on s’en rende compte, on bascule dans un monde étrange et troublant. Quand le film se termine, j’aimerais que le spectateur ait l’impression que sa propre vie « ordinaire » est la continuation de ce qu’il vient de voir. Que la frontière entre le film et le quotidien se soit brouillée. Que le film ait infiltré sa réalité. Dans un monde où les gens sont sans cesse absorbés par leurs téléphones, je crois que cette forme d’expérience immersive est le plus beau cadeau que le cinéma puisse offrir.
Crédit photos : © 2025 Exit 8 Film Partners